
L’espace d’exposition s’élève au dessus des collections permanentes du Quai Branly et les voilent du regard de grands filets enveloppant les murs dans un cocon dépaysant, éclairé par une lumière tamisée. Entre nattes tressées, masques au mur et fleurs chatoyantes, un simulacre de bar hawaiien nous immerge tout de suite dans le thème de Tiki Pop.
Tiki désigne à l’origine la représentation des dieux, en des termes abstraits dont le sens fluctue en fonction des îles et des cultures polynésiennes. Or, ceux qui s’attendent en entrant à une observation méticuleuse de la culture des îles du Pacifique seront déçus ! Ici, ce ne sont pas les dieux polynésiens qui dominent la situation, mais bien ceux qui en rêvent pour recréer leurs propres ambiances, les érigeant en dieux, oui, mais du divertissement à l’américaine.
Ici en effet, c’est bien le sujet occidental et américain qui est observé sous toutes ses coutures, à travers l’adaptation de la culture polynésienne à un idéal du loisir américain pendant les années 50. La phrase d’accroche de l’exposition, « L’Amérique rêve son paradis polynésien », définit tout un phénomène social et culturel, fulgurant mais prolifique avant sa mort dans les années 60. Entre ‘pop culture’ et appropriation, le mouvement tiki naît comme un désir de créer une aura d’exotisme et d’évasion pour une classe américaine aisée mais stressée, cherchant à égayer son quotidien en dehors des banlieues résidentielles et des bureaux. Le mouvement tiki cherche avant tout à créer un cadre utopique virant rapidement sur le kitsch. Pourtant, cette production de masse et ces escapades du dimanche donneront également lieu à des projets architecturaux et des objets considérés comme modernistes et percutants. Fantasme de mauvais goût ou hommage esthétique ? Ici, ni l’un ni l’autre ne paraissent très éloignés…

Le début de l’exposition montre bien que cette fascination étrange avec la culture polynésienne existe déjà bien avant les années 50. Les récits des navigateurs rapportent leur point de vue particulier de ces îles du Pacifique et de leurs habitants. Entre stéréotypes et points de vue du colonisateur européen, ces récits servent surtout à alimenter une envie d’escapade via l’exotisme, comme celle de Gauguin avec son récit Noa Noa. Mais le vrai ‘tiki pop’ américain commence après 1945 et la Guerre du Pacifique, pendant laquelle les soldats américains ont pu parcourir ces îles variées du Pacifique. L’envie de romancer ces expériences afin d’oublier les troubles de la guerre prend d’assaut Hollywood, alors que le film Bounty Hunter, traitant d’une mutinerie au sein d’un vaisseau anglais du XVIIIe sur les côtes de Tahiti, fascine le public avec ses plages de sable fin, son cadre luxuriant, son esprit d’aventure et son érotisme sous entendu. La fiction rejoint la réalité alors que Marlon Brando, qui y joue un lieutenant épris d’une jeune tahitienne, finira par épouser l’actrice, Tarita Teriipaia, et achètera même une petite île près de Tahiti, Tetiaroa. L’obsession similaire autour du récit du Kon-Tiki, l’aventure d’un homme recréant et naviguant une pirogue pour prouver que les Tahitiens ont migré d’Amérique du Sud, devient un succès à l’écrit comme à l’écran. Les bars et restaurants qui commencent à fleurir dans la région de la Floride et de la Californie sont partis d’une première initiative visant à réutiliser les décors de ce genre de films. Ainsi, les bars tiki devinent les produits dérivés d’un fantasme Hollywoodien, déjà inspiré largement du mouvement de « primitivisme » datant de l’Europe du 19ème siècle. Un parcours complexe qui vaut largement celui du Kon-Tiki !

Ce nouvel engouement coïncide avec le nouveau statut d’Hawaii en tant que 50ème état américain, en 1959. A la fois suffisamment « officiellement » américaine pour être acceptable mais suffisamment éloigné de la vie du cadre moyen américain pour être « exotique », cette nouvelle esthétique fait donc rapidement fureur, que ce soit sous forme de bars, de restaurants ou mêmes de parcs d’attractions et d’îles urbaines emménagées. Circulant librement entre les vitrines d’expositions, on retrouve pêle-mêle des cartes de cocktails fantaisies au rhum (boisson, qui au demeurant, provient des Caraïbes et n’a rien à voir avec la Polynésie !), des pin-up de hula girls en jupettes de feuilles et couronnes de fleur, et des imitations des fameuses statuettes tiki sous n’importe quelle forme, incluant des mugs et des savonnettes. L’esthétique tiki est distillée sous toutes ses formes et a pour but de suggérer un certain mode de vie décalé et idyllique à un public ingénu.

L’immersion est portée à l’extrême et cet extrême demande souvent un sens du détail similaire aux gravures minutieuses sur bois des cultures usurpées. Les véritables statues et ustensiles, elles, semblent surveiller d’un œil sévère ces imitations qui créent un amalgame généralisé à partir de plusieurs cultures. Le terrain pourrait être délicat : est-ce qu’il est appréciable d’admirer des versions hybrides et exagérées de cultures authentiques et de mettre en avant cette esthétique plutôt que de consacrer davantage de place au kitsch qui en a dérivé ? L’exposition préfère laisser les confrontations visuelles parler d’elles-mêmes. Le bol à nourriture provenant d’Hawaii, tout en abstractions épurées et élégantes, se rapproche d’un design simple mais attrayant bien davantage que le mug censé imiter une certaine esthétique de la vie idyllique et sauvage, avec un côté « imitation épave ».


L’exposition, à la fois incisive et subtile, ne cherche jamais à créer d’excuses pour le caractère raciste et sexiste du mouvement tiki, ainsi que son manque de respect flagrant. Pourtant, il n’interdit en rien le fait de reconnaître ses défauts tout en appréciant le soin des détails d’un phénomène d’apparences superficielles et cheap. Ce qui interpelle et qui fascine dans cette exposition, ce n’est pas uniquement la portée historique et anthropologique du mouvement tiki en termes de concepts ou de films, qui demeurent relativement simplistes : il s’agit avant tout des déclinaisons de formes, de design et d’esthétique au niveau de l’architecture et des objets du quotidien. L’espace en compte 450, démontrant la variété étonnante d’un mouvement qui se veut pourtant avant tout réducteur de plusieurs cultures riches et complexes. Même si plusieurs de ces produits sont destinés à un usage commercial, d’autres sont le résultat d’observations et de recherches détaillées, créant des objets uniques en leur genre. Ainsi, les restaurants, bars et mêmes parcs d’attraction n’en restent pas à quelques éléments décoratifs afin d’insuffler à leurs visiteurs une ambiance « tiki » : ils observent de très près les objets de la culture qu’ils édulcorent pour en faire leur version déclinée en objets commerciaux et modifient même leur style d’architecture en conséquence, adoptant une charpente en « A » emblématique des constructions traditionnelles polynésiennes.

Est-ce que l’on est encore sous l’emprise de ce tiki pop? Le phénomène en soi a été très court et très concentré, atteignant la classe moyenne des américains, surtout en Floride ou en Californie, et parmi ceux là, plutôt les cadres aisés entre 30 et 40 ans, épargnant les jeunes qui se tourneront plutôt vers le rock et le flower power. Une vague culturelle faite de musique pop, de drogue et d’érotisme se fera entendre dès les années 60 et noiera ce petit épisode de kitsch des îles encore léger et bon enfant. La génération suivante, avec davantage d’accès à une éducation universitaire, sembla plutôt gênée par les amalgames racistes et sexistes de leurs parents, préférant au tiki pop le peace and love. Il n’a pas disparu entièrement pour autant, après une deuxième vague d’influences empreintes de nostalgie pendant les années 90. Au contraire, se diluant plutôt au sein de micro-appropriations culturelles et hybridités plus ou moins désirables, au sein d’espaces mondialisés et hyper connectés. Le fait-on avec davantage de motivation et de sensibilité que le simple désir de fuir la grisaille du quotidien, affublé d’un ukulélé et d’une chemise à fleurs ? Cela reste à voir. Dans tous les cas, maintenant que la rentrée s’annonce et que la plage est déjà bien loin, le moment est idéal afin d’observer notre beach culture d’un regard plus anthropologue.


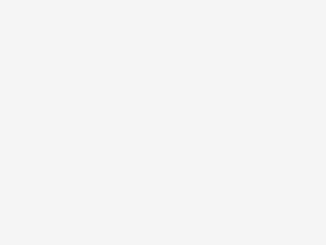
Soyez le premier à commenter