
ROMAN HISTORIQUE — Sylvie Gibert est coutumière des romans historiques ; L’Atelier des poisons vient à la suite de quelques titres traitant de différentes époques. Celui-ci fait évoluer ses personnages au XIXe siècle.
Paris, 1880. Zélie Murineau apprend le métier de peintre à l’Académie Julian, le premier atelier à ouvrir ses portes aux femmes. Ardu, long, coûteux (deux fois plus pour les femmes que pour les hommes, d’ailleurs…) et seules les jeunes femmes dotées, à la fois, d’un grand talent et d’une grande force de caractère parviennent à surmonter les obstacles de la formation.
Or, cela tombe bien, Zélie ne manque ni de l’un, ni de l’autre. Pour se payer l’Académie Julian, elle a même commis un faux Velázquez. Il semblerait d’ailleurs que le commissaire du quartier du Palais-Royal, Alexandre d’Arbourg, n’en ignore rien, au vu des subtiles allusions qu’il y fait en demandant à Zélie d’effectuer un portrait de sa filleule. Il y adjoint une autre demande : Zélie sera, chez son cousin, ses « yeux » et devra trouver qui, au sein de la famille, a souhaité empoisonner avec des graines d’if le maître de maison. Mais Zélie ne se laisse point marcher sur les pieds : elle exige du commissaire qu’il enquête sur le bébé de la nourrice dont Zélie réalise le portrait… enfant qui a mystérieusement disparu alors qu’il était en route vers la ferme familiale. Le commissaire a fort à faire : il doit également gérer une vague de crises de folie qui frappe Paris, transformant de paisibles Parisiens en monstres sanguinaires assoiffés de violence.
Ce n’est pas tant pour les intrigues policières que pour la toile de fond historique qu’il faut lire L’Atelier des poisons. En effet, Sylvie Gibert soigne ses ambiances avec un luxe de détails infini, qui font qu’on a proprement l’impression de plonger dans ce Paris du XIXe. D’autant qu’on en explore tous les recoins : des salles du Salon aux pièces de l’Académie Julian en passant par les tripots douteux des bords de route et autres bas-fonds, on a un aperçu plutôt complet de cette capitale moins ouverte d’esprit qu’il n’y paraît.
L’intrigue, de fait, offre une large réflexion sur la place des femmes dans cette société : bourgeoise, nourrice, artiste, ouvrière ou aristocrate les femmes sont nombreuses dans ce roman et aucune n’a de statut vraiment enviable. La réflexion porte également sur l’évolution du monde moderne : alors que le monde de la peinture reste figé dans les portraits académiques et les toiles très figuratives (de préférence inspirées de la mythologie), les lignes bougent : pour l’exposition, Zélie effectue le portrait d’une nourrice avec l’enfant dont elle a la charge (un choix très audacieux) et les impressionnistes se font de plus en plus remarquer, au grand dam d’une frange – encore importante – tenant d’un classicisme rigoureux.
Les intrigues policières, elles, s’entrecroisent et progressent par petites touches : elles se nourrissent des diverses réflexions et sont alimentées, au vu de leur nombre, par un suspens qui tient le lecteur en haleine, sans toutefois faire sombrer le roman dans un rythme effréné et épuisant. Sylvie Gibert parvient à marier enquête, toile historique et réflexions de fond avec brio.
En somme, voilà un roman qui devrait plaire aux amateurs de polars historiques soignés !




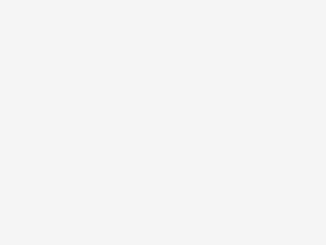
Soyez le premier à commenter