
Les néons clignotants nous accueillent comme des enseignes énigmatiques de magasin alors que les couloirs immaculés de l’exposition accueillent la palette acidulée de Martial Raysse, dans sa rétrospective au Centre Pompidou. Un des artistes français les plus importants d’aujourd’hui, un pionner français du Pop Art…même si cette étiquette n’est probablement pas celle qui lui plairait le plus à présent. Qualifier Raysse d’Andy Warhol français serait en effet réducteur par rapport à ce travail qui a évolué tout en richesses et en nuances le long de cinquante ans de carrière. Elle commence dans les années 60, alors que Raysse s’inspire des publicités et supermarchés, évidemment proche de Warhol et Lichtenstein, autant à travers ses portraits utilisant les couleurs vives et le kitsch des comics américains qu’à travers cette utilisation à la fois ironique et idolâtrique des produits de marque, récupérés au Prisunic, un supermarché de l’époque. Il le qualifie d’ailleurs de « nouveau musée d’art moderne », bien en phase avec l’attitude ambiguë du pop art envers cette société de consommation, entre fascination et critique.
Ses amalgames de produits vaisselle créent des petits totems à la société de consommation, leurs formes artificielles créent des formes ironiquement organiques dans Etalage de Prisunic, Hygiène de la Vision No1 (1961). Ces structures se juxtaposent aux portraits de femmes qui semblent tous droit découpés de magazines géants ; parmi les modèles imitant ces poses de rêve figure d’ailleurs sa femme, France, nous épiant dans La France Verte (1963), ornée d’une fleur et d’une mouche en plastique superposées sur son visage espiègle. A ces couleurs vives s’ajoutent des sons et des reconstructions d’installations insolites, telles que le petit coin de sable dans Raysse Beach (1962-2007) qui rassemble ces baigneuses peu ordinaires. Et pourtant, la fascination avec le classique émerge parmi ces amalgames de collages de magazines et de produits de consommation, avec le même désir de parodier et subvertir ; les baigneuses de Raysse sont confrontées par l’Odalisque d’Ingres.
Elle apparaît dans sa série Made in Japan, les couleurs en aplat se mêlant à des objets directement collés sur la toile, la rendant multidimensionnelle et multi-sensorielle…un collage qui a dépassé les restrictions superficielles de son tableau. C’est presque comme si ces objets matériaux, commerciaux qui fascinent Raysse veulent s’expulser hors de la toile et demeurer à mi-chemin entre les baigneuses et leurs spectateurs, promettre un coin d’utopie et de divertissement. Peut-être est-ce le lien entre Ingres et Raysse…celui du fantasme. Le désir d’entrevoir et de posséder, que ce soit en épiant un harem luxueux ou en voyant une publicité pour des vacances sur une plage de sable fin. Elles sont entourées par ces immenses structures de néon qui font tantôt penser à des machines de casino lyriques et surréalistes.
Un surréalisme qui se confirme, teinté d’insolence et de parodie, à la fois drôle et innovateur alors qu’il se lance dans le film. Dans Suzanne, Suzanne il revisite Suzanne et les Vieillards de Tintoret en projetant, à l’arrière du tableau revisité, un film de l’artiste Arman jouant le « voyeur » modernisé. Ses publicités parodiques, crées avec ses amis artistes, ont un goût un peu plus décousu et délirant, comme une blague d’initiés. Même les victimes malheureuses d’un western extravagant dans le court métrage Jésus-Cola ont du mal à arrêter de sourire alors que dans Camembert Martial Extra-Doux, une danseuse se tortille devant des images absurdement superposées. Malheureusement les deux salles de projection sont si proches l’une de l’autre et peu isolées que leurs bruits se couvrent mutuellement et rendent parfois la musique ou les dialogues difficiles à entendre ou comprendre ! Peut-être cela rajoute-t-il involontairement à l’esthétique absurde…
Le Grand Départ, un grand film énigmatique aux couleurs inversées, symbolisant un voyage initiatique faisant encore une fois référence à des références de tableaux classiques, nous mènent vers un amoncellement un peu plus confus de ses œuvres suivant cette époque très clairement engagée dans ses installations surréalistes et hautes en couleur. La couleur, elle, demeure, mais les tableaux demeurent sagement à plat, sans déborder du cadre, des coups de pinceau précis de peinture à l’huile. A présent peinture et sculpture sont bel et bien séparés. Mais leurs sujets, eux, sont loin d’être tout à fait sages et ordonnés : de scènes inspirés de la mythologie grecque et de portraits colorés, en passant par des sculptures délicates de faune et de flore un peu féériques, l’on en finit sur d’immenses tableaux aux personnages bariolés, impliqués dans des fêtes décadentes et joyeuses, à la fois tragiques et comiques. Ce parcours est surprenant : on a tendance à imaginer que le parcours des artistes modernes se fait de la figuration à l’abstraction et non l’inverse. Or, Raysse ne semble pas satisfait par le désir de suivre un chemin tracé, même si celui-ci est teinté de parodie et de subversion enjouée. Il a délibérément choisi de se détacher du pop art puis de l’abstraction pour un parcours qui, finalement, en revient aux sources explorées au tout début dans les tableaux des grands maîtres, restant dans la représentation de scènes et de personnages sans pour autant de perdre dans le réalisme, au contraire. Changement complet ? Pas tout à fait. Sa palette multicolore est toujours là, ainsi que le sentiment d’utopie mêlée à un brin de malaise, comme si la fête éternelle pouvait s’achever brutalement à tout moment.

En théorie, les rétrospectives se concentrent sur la vie de l’artiste et ce qui l’a motivé à établir ses choix artistiques, à travers des panneaux explicatifs parsemés à travers l’exposition. Mais cette rétrospective, à l’image de son artiste, ne semble pas jouer la carte du prévisible. Mis à part un petit livret à l’accueil, l’exposition en soi était en général silencieuse sur la vie de Raysse en soi et peu claire sur ce qui l’avait amené à sa fascination avec le plastique et la société de consommation, puis de se tourner vers de grandes peintures monumentales allant de plus en plus vers un mouvement à la fois surréaliste et naïf. Cela peut avoir des conséquences négatives autant que positives. D’un certain point de vue, cela peut montrer la perte d’un fil narratif, malgré l’ordre chronologique, un cheminement où on a vite fait de se perdre, et d’atteindre la fin avec un sentiment de confusion. En même temps, cette absence de fil conducteur centrée autour de la vie de l’artiste mérite-t-elle une histoire avec un point final quand lui-même a encore le reste de sa vie et de sa carrière artistique imprévisible devant lui ? Le silence dans les grandes lignes est comblé par des explications plus approfondies pour ses œuvres phares.
Martial Raysse ne semble pas vouloir établir de parcours tout tracé, ni d’appartenance claire à un mouvement, et cette exposition reflète cette effusion d’idées et de couleurs, de techniques et matériaux innovateurs alliés à un hommage envers les sujets traditionnels de la peinture. L’humour, lui, est toujours présent au moindre détour et détournement des sages icônes de l’histoire de l’art. Décalée et envolée, cette exposition surprend en douceur et réinjecte un peu de loufoque coloré au cœur de Paris sous la grisaille. Ce ne sera jamais de refus, à visiter et revisiter jusqu’au 22 septembre.
Par Claire Mead

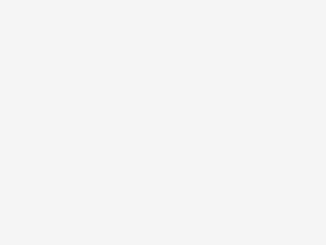
Soyez le premier à commenter