
My Skinny Sister, le titre du film de la réalisatrice suédoise Sanna Lenken parle de lui-même. En effet, ce film parle d’un sujet fort et intime : l’anorexie. Présente à l’avant-première du 10 novembre 2015 au MK2 Hautefeuille, la réalisatrice a confié combien ce sujet lui est personnel, « j’avais cette histoire dans le sang » dit-elle. Mais au-delà de la maladie, c’est l’onde de choc sur toute une famille que montre avec sensibilité ce premier long-métrage.
L’histoire est simple. Katja, une jeune fille passionnée de patinage entre dans un processus inquiétant : surentraînement, humeurs en dents-de-scie et obsession pour la nourriture… Autour d’elle, personne ne prend la mesure de ce qui se passe, hormis sa petite sœur Stella qui finit par alerter les parents, alors dépassés par la situation.
Le film est construit sur plusieurs trames qui s’entrecroisent : la préadolescence de Stella, dont le corps et les émotions expérimentent le désir et la volonté de plaire, la personnalité de l’aînée, Katja, belle et talentueuse patineuse qui s’entraîne pour la compétition et le couple des parents, un couple ordinaire : aimant et pris par sa vie professionnelle.
Un point de vue déporté
C’est par le regard de Stella, petite sœur un peu boulotte, touchante dans son admiration pour la beauté et les qualités sportives de sa grande sœur, que le spectateur rentre dans la vie de cette famille. Complice involontaire du secret que sa sœur l’oblige à garder, Stella se trouve seule face aux troubles alimentaires de sa sœur, troubles dont la gravité et les conséquences la dépassent. Petit à petit, elle va trouver le courage de résister et de se positionner, faisant ainsi par ricochet réagir les adultes.
Ce choix de focalisation interne via le personnage de Stella permet de porter un regard à la fois distancié, candide, exempt des outils d’analyse adulte, mais sain, sur une situation qui avance à grands pas vers le drame : Katja, sa sœur, est en danger de mort.
Ce point de vue narratif est souligné par la caméra qui suit Stella, avec des gros plans sur son visage ou encore de longs moments sur son corps tourné contre la vitre de la voiture parentale, observant le paysage qui défile sous ses yeux. Ces moments de déplacement dans l’espace sont comme des instants arrêtés, formant des temps morts dans une angoisse intérieure que l’on sent monter. Tous ces moments passés à observer le paysage semblent symboliser l’incompréhension et l’impuissance de l’enfant face à des événements qui s’enchaînent sans qu’elle puisse les déchiffrer ou les arrêter.
Des thématiques existentielles
Le thème de la maladie et ses conséquences sur la cellule familiale sont le cœur du film. Les questions du soi, de l’apparence et du regard de l’autre sous-tendent en permanence ce récit du mécanisme anorexique, vu sous le prisme de la dépendance et de l’enfermement. La réalisatrice a répété sa volonté de parler de ce déséquilibre général produit par la maladie et qui entraîne dans sa destructivité un système familial reposant sur la confiance et le partage. Ainsi au cours du film, on suit le parcours des parents, d’abord aveugles au problème, puis cherchant à le minimiser. Croyant bien faire, ils pensent pouvoir régler le problème par eux-mêmes, en ressoudant la cellule familiale par un week-end de retrouvailles dans la cabane de vacances. Le week-end salvateur tourne à l’horreur et ils se trouvent face à une souffrance psychique et physique qui, comme tout processus d’addiction, nécessitent une aide médicale adaptée.
Cet épisode de tentative de refuge à la campagne, essai de protection du cocon familial autour de l’ado en souffrance, est assez émouvant, comme si les parents tentaient un ultime retour à la nature, aux valeurs solides, le bois, la forêt, les éléments pour guérir leur enfant des maux venus de la société. Ce passage permet aussi d’illustrer le rapport difficile qui s’installe, entre besoin d’aide, appel au secours et refus de toute assistance, qui finit par creuser une faille entre les membres de la famille, rejetant chacun face à lui-même dans une solitude extrême.
Un parti pris esthétique
Les images sont belles, claires, avec des gros plans sur les visages, la peau, les cheveux roux qui s’entremêlent, comme autant de symboles de la complicité entre les sœurs mais aussi du rapport au corps, à sa matière et à sa sensualité. Des images qui font penser à l’esthétique de certaines photographies de Sarah Moon ou aux tableaux du peintre Rossetti, images de féminité, de trouble et d’intériorité.
Au cours du film, on ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour d’autres réalisateurs comme Sofia Coppola notamment dans Virgin Suicide ou Terrence Malick dans The Tree of Life, ou encore Xavier Nolan. Avec un peu moins de virtuosité et d’urgence que ce dernier, le mouvement lent de la caméra, les images presque fixes par instants, les répétitions de plans comme un fil rouge, les déplacements parvenant à matérialiser l’errance et le cheminement intérieur, signent une esthétique et une manière très personnelle de parler de la complexité des rapports humains.
Néanmoins, ce parti pris de lenteur, qui renvoie peut-être à ce processus d’anorexie, extinction progressive et marche inéluctable vers la mort, déteint parfois sur tout le film, produisant pour le spectateur des instants où il décroche de la narration.
Ces longueurs sont rattrapées par la grande réussite des deux personnages principaux, incarnés par deux jeunes actrices excellentes. Leur naturel, les dialogues et réparties pleines d’humour et de naturel sonnent toujours justes et contribuent à donner sincérité et tendresse aux situations. La jeune actrice, Rebecka Josephson qui joue Stella est, nous dit la réalisatrice, dans la vie comme dans le film : spontanée, drôle, espiègle. Quant à Katja, elle est incarnée par Amy Deasismont, une chanteuse suédoise, la Jennifer de la Suède nous dit-on, un choix que la réalisatrice n’aurait pas envisagé au départ. Mais la jeune star a su faire oublier son image de vedette et trouver en elle comment jouer ce personnage tout en finesse et intériorité.
L’anorexie racontée à tous
« Il y a peu de films sur ce sujet« , nous dit Sanna Lenken. « Je voulais en parler. »
Son film a reçu l’Ours de cristal au dernier Festival de Berlin, par le jury « génération », ce qui veut dire primé par de jeunes spectateurs. Des spectateurs en âge de Katja, pour lesquels ce film est un moyen de dire et de comprendre un mal-être ou une situation qu’ils peuvent rencontrer.
Par son inspiration autobiographique et ses possibilités d’identification, ce film prend une valeur de témoignage, un effet miroir de génération et servira peut-être de prise de conscience pour les uns ou les autres. Que ce soit pour des spectateurs adolescents ou des parents, il pose un constat : voilà ce qui se passe, l’anorexie est une maladie qui, comme toute maladie au sien d’une famille, détruit unité et équilibre. Le propos ne cherche ni à culpabiliser ni à dédramatiser, il essaie de montrer le plus sincèrement possible la réalité d’un quotidien disloqué. Car « l’anorexie est une prison », dit Sanna Lenken.
Le film montre à tous que l’on peut en sortir. Par des mots, des voix. Par un refus du déni. Par des soins appropriés. Par l’action, nous dit la réalisatrice, ce qui, pour elle, est passé par la volonté de faire des films, ce film.
À la fois témoignage et catharsis, My Skinny Sister parle de grandir et de vivre, mais il parle essentiellement de liberté, celle que l’on perd dans le processus d’anorexie et qu’il est possible de retrouver. Symboliques, deux scènes de la même tonalité poétique ouvrent et concluent le film : Stella observe un scarabée, puis elle le lâche dans la nature. Impliqué et lumineux, ce film est un bel hommage à la création et à la capacité de tout art à sublimer la vie : il révèle une réalisatrice sensible, Sanna Lenken dont on a hâte de découvrir les prochains films.



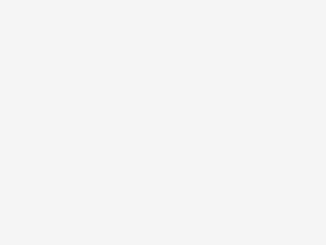

Un film que je viens de repérer sur le site « sens critique ». Ton avis ne fait que conforter mon envie de le regarder! 🙂