Ville noire, ville blanche est un de ces romans qui suscitent la polémique et les passions : l’on aime, ou l’on déteste. Du fait d’un sujet choc, d’une violente latente, et d’un rythme très lent, le livre peut fortement déplaire, comme il peut séduire son lecteur.
L’histoire a tout du fait divers sordide qui hante les pages du New York Times : une jeune femme blanche se fait voler sa voiture dans un quartier difficile de la banlieue new-yorkaise et se réfugie, les mains en sang, dans un hôpital. Une histoire somme toute banale…Mais la voiture de la jeune Brenda n’était pas vide : son fils, quatre ans, dormait à l’arrière. Très vite, des contradictions apparaissent dans son récit. Mais la machine se met en branle : le contre-la-montre a commencé, la vie d’un enfant est en jeu. La police investit les quartiers sensibles et inexorablement, la tension montre entre les deux communautés, la blanche, et la noire.
Roman très long, de six cents pages, Ville noire, ville blanche (Freedomland en version originale) est moins un roman policier qu’un roman social. D’un rythme très lent, très descriptif, l’on pourrait presque y voir un état des lieux des banlieues new-yorkaises à la fin des années 90. A travers le regard de l’inspecteur Council, nous découvrons des quartiers rongés par la drogue, l’alcoolisme, la violence. Le cas de Brenda, la victime, n’est pas quelque chose de rare : le carjacking, c’est presque de la routine pour les polices de Gannon et Dempsy, les deux banlieues dont il est question dans ce roman. Là où l’histoire de Brenda intéresse la presse, c’est à cause de la présence de Cody, quatre ans, dans la voiture, et de la personnalité de la mère, ancienne droguée, travaillant dans un centre d’étude dans un quartier sensible. Une personnalité qui n’échappe pas à Jesse, jeune journaliste ambitieuse, et un des trois personnages les plus importants du récit. Mariée à son travail, prête à tout, mais tout de même capable de compassion, Jesse est à l’image du lecteur : incapable de trancher, et de deviner ce que cache l’étrange mutisme de Brenda.
Au-delà d’une enquête policière visant à retrouver un enfant, Ville noire, ville blanche est avant tout une véritable fresque sociale : grâce à de nombreux personnages, le lecteur a un aperçu de la vie à Dempsy et Gannon, d’un quotidien fait de violences conjugales, de deal, de chômage. Ce roman montre aussi comment des banlieues peuvent s’emparer d’un fait divers et s’embraser : il montre comment la violence peut monter, monter jusqu’à exploser brutalement. Il dévoile aussi comment la haine et les préjugés raciaux peuvent empoisonner tout un voisinage. Tout cela donne un roman très sombre, très psychologique, avec de très nombreuses descriptions, qui ont malheureusement lassé de nombreux lecteurs. Cependant, elles sont totalement nécessaires à la construction de l’intrigue. Le récit policier devient presque secondaire, s’efface devant ce portrait vibrant de la banlieue de New York des années 90. Difficile de passer à côté d’un tel roman, qui n’est pas sans rappeler Le bûcher des vanités sur bien des aspects, des inégalités sociales, à l’importance de la presse.



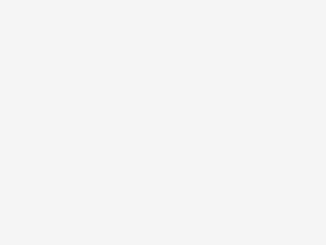
Et bien, c’est chouette que tu aies aimé finalement ! Ton parallèle avec le Wolfe me donnerait presque envie de retenter ce livre mais je sais que je ne pourrais pas supporter sa violence « crue » (parce qu’au fond le Wolfe est très violent à sa façon, mais j’arrive bien mieux à « encaisser » ce genre de violence sournoise).
on accroche ou pas à ce livre, malgré des moments lents, le fond est très riche
Ta chronique est intéressante. Il faut vraiment que je me fasse mon propre avis sur ce livre qui m’intrigue depuis bien longtemps …
Effectivement la violence n’est pas tout à fait la même, mais l’ambiance est très semblable.